Attention : réflexion ! Créé en 2020, le Centre national de la musique s’est vite doté d’un think tank, le CNMlab, qui associe le monde universitaire aux spéculations sur l’avenir du secteur. L’une de ses premières publications est « La musique en mouvements, horizon 2030 », intégralement disponible en ligne. Il y est question d’intelligence artificielle, de livestream, d’algorithmes de recommandation mais aussi de décroissance, grâce au philosophe Alexandre Monnin et au chercheur Nathan Ben Kemoun. Dans un article intitulé « La sobriété comme suffisance intensive, l’exemple de la musique », ils reviennent sur l’histoire du concept puis sur la dépendance du quatrième art au numérique et au transport aérien avant d’ouvrir vers d’autres possibles, notamment le simple plaisir de jouer. Doctorant à l’université Paris-Dauphine, Nathan Ben Kemoun développe ses idées.

Vous introduisez de nouveaux mots dans le débat sur la question de l’écologie de la musique, cela apporte de nouveaux points de vue… Je voudrais m’arrêter sur l’un de ces mots : « ludique ». Qu’est-ce que cela change que la pratique musicale soit « ludique » ?
Nathan Ben Kemoun : « Nous utilisons l’adjectif « ludique » par opposition à l’adjectif « productif ». Ce qu’on essaie de mettre en évidence, c’est qu’en France, contrairement à d’autres pays d’Europe (notamment l’Allemagne), les pratiques musicales amateures sont peu investies. Dans ce texte, on essaie de faire le lien entre la sobriété, c’est-à-dire le choix d’un mode de vie raisonnable, décent, avec une manière différente de consommer, et le réinvestissement d’autres manières de générer des formes de satisfaction. Or, l’une des sources possibles de plaisir – et notre inspiration vient aussi du travail du sociologue Antoine Hennion sur ce sujet – pourrait justement être ce réinvestissement de la pratique amateure. Qu’est-ce que cela change que cette pratique ne soit pas productive ? Il se trouve que l’orientation vers la sobriété doit intégrer une réflexion sur le numérique, sur la dénumérisation du monde et notamment la dénumérisation du monde musical. Il est intéressant d’observer que les pratiques amateures, qui ne donnent pas lieu à une activité de production ou de diffusion, ont aussi la vertu de s’inscrire dans une forme de dénumérisation. C’est aussi ce que l’on entrevoit dans le travail mené autour de la low tech : le low tech vise à réinscrire les modes d’existence dans des technologies plus douces (au niveau de l’impact environnemental et de la consommation énergétique), de façon à rendre la production compatible avec le nouveau cadre posé par l’anthropocène. Je fais un aparté : l’anthropocène n’est pas une crise écologique, comme on peut avoir une crise d’acné avant que les boutons ne repartent. L’anthropocène est une nouvelle situation, dont l’histoire nous enveloppe et nous engage durablement, avec des pertes que l’on sait aujourd’hui irréversibles. On ne pourra pas faire machine arrière. À partir de là, il faut penser le devenir le « moins pire », comme disent les enfants, et, en l’occurrence, ce devenir pourrait être du côté des pratiques amateures. Si la musique est largement réinvestie au niveau de ces pratiques, peut-être pourrait-elle accompagner le déplacement des modes d’existence vers plus de sobriété. Il y aurait à la fois moins de production et moins de consommation de musique sur des plateformes numériques. »

L’avenir serait au débranchement ?
Nathan Ben Kemoun : « En sociologie, des enquêtes ont porté sur les personnes qui essaient de se déconnecter. Elles ont décidé de réduire leur consommation de numérique, de n’accéder à ces services qu’à certains moments de la journée par exemple. Elles ont pris conscience de la place occupée par le numérique dans leur existence. Chacun peut repenser la place qu’il souhaite accorder au numérique. Toutefois, nous manquons aujourd’hui d’une réflexion collective, politique et démocratique, sur ce à quoi nous allons renoncer pour défendre ce à quoi nous sommes attachés. Différentes échelles devront alors être mises en rapport, et notamment, l’échelle des modes d’existence avec celle des orientations politiques »
Vous écrivez que « la consommation de musique est devenue un dispositif bien plus coûteux que la pratique musicale ». Est-ce que ce n’est pas le cas depuis longtemps déjà ?
Nathan Ben Kemoun : « On distingue deux choses qui sont aujourd’hui bien plus coûteuses – en termes de consommation d’énergie – qu’à d’autres époques. Une manière de dater l’anthropocène consiste par exemple à en parler à compter de ce qu’on appelle « la grande accélération », c’est-à-dire les années 1950. Avant cette période-là, la manière dont la musique était diffusée n’était pas aussi coûteuse qu’elle l’est aujourd’hui. D’abord du point de vue de la distribution numérique ; ensuite sur le plan de la scène musicale. Il y a des spécialistes du coût environnemental des concerts et des tournées, comme François Ribac. Il démontre que toute l’infrastructure, matérielle et logistique, et les mobilités associées à cette production n’est absolument pas compatible avec les enjeux ouverts par l’anthropocène. »
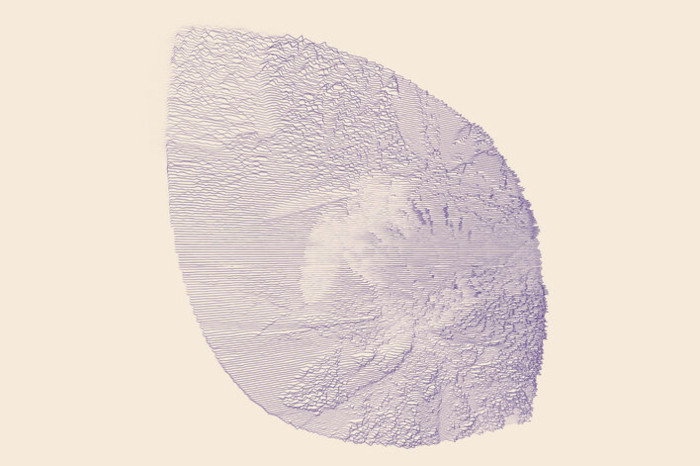
Qu’est-ce que la « sobriété intensive », que vous appelez de vos vœux ?
Nathan Ben Kemoun : « Depuis les travaux de Paul Ariès et Serge Latouche en France, et souvent dans la continuité des textes importants d’Ivan Illich ou d’André Gorz, nous avons eu tendance à parler de « sobriété » pour qualifier des formes de modération, de diminution et de tempérance. Des formes de vie caractérisées par de l’auto-limitation et la recherche d’une vie matérielle décente mais modeste, voire frugale. Les débats autour de la sobriété concernent généralement les modes d’existence et tournent leurs regards vers l’horizon d’une modération impérative. En complémentarité, mais aussi en contraste, avec cette lecture de la sobriété (surtout caractérisée par le passage d’un « plus » à un « moins », d’un « trop » à un « suffisant »), nous proposons de réinscrire la perspective de la sobriété dans une autre axiologie, dans un autre sillage et une autre interrogation : la question des technologies et de leur poids matériel, énergétique, et souvent insoutenable.
Nous plaidons alors en faveur de la recherche d’usages du plaisir différents, en intensité, et non en extension : des moments de satisfaction et de joie, adossés à des infrastructures sobres sur le plan extensif, énergétique et matériel. La « suffisance intensive » dont nous parlons aurait vocation à déplacer la recherche d’infini (« infini » s’opposant à « illimité ») de la sphère extensive vers la sphère intensive. Le passage de la production au jeu, en matière musicale, s’inscrirait notamment dans cette perspective. Il ne faut pas y voir une remise en cause ou une atténuation de la nécessité de fermer certaines activités et infrastructures, caractéristique d’une sobriété assumée, mais bien la reconnaissance que ce travail ne touchera pas toutes les dimensions de l’existence et de la technique. Il sera alors pertinent de combiner des efforts de fermeture avec des sillages d’ouverture ou de réouverture. Le réinvestissement des pratiques musicales amateures (où le plaisir découle à l’infini de l’exercice, de la répétition et de la formation d’une sensibilité auprès d’un même instrument, utilisable longtemps) irait précisément dans le sens d’une recherche d’intensité : davantage de gestes, de pratiques, de plaisirs et de formation sensible, avec moins de technologie lourde, onéreuse, insoutenable au plan énergétique et matériel. L’intensification des modes d’existence se situe à l’intersection des usages du plaisir et des technologies qu’ils impliquent : comment fermer ou démanteler les infrastructures et activités non-soutenables, tout en redistribuant les cartes du plaisir, du geste et de la transmission sur des technologies plus légères et des activités à soutenabilité forte. »
Est-ce pour vous le début d’une réflexion au long cours sur les rapports entre musique et écologie ?
Nathan Ben Kemoun : « Pour Alexandre, je ne sais pas, il faudra lui demander. De mon côté, c’est une question importante, oui. Je m’en suis rendu compte tardivement. J’ai d’abord travaillé sur ce que j’ai appelé des « parcours de convalescence » : chez des personnes qui changent de modes de consommation, pour des raisons personnelles de reconversion, suite à des ruptures plus ou moins brutales dans leur trajectoire vie (blessure physique, ruptures amoureuses, périodes de chômage, reconversion professionnelle). En parallèle, je suis musicien. Je suis guitariste depuis longtemps. L’une des orientations que j’ai empruntées, à l’échelle très étroite de mes propres attachements cette fois, pour concilier les impératifs de déconsommation et la nécessité de conserver une vie riche et intéressante, c’est justement la pratique de cet instrument. Il existe probablement un lien entre la redirection écologique et la pratique amateure. Mais il faudra relancer l’enquête, prolonger les enquêtes existantes, avancer en ce sens. À titre personnel, j’aimerais beaucoup continuer à travailler sur ce sujet, à retisser des ponts entre ces notions, dans la continuité des travaux de François Ribac, notamment, qui est davantage spécialisé sur ces articulations entre musique, écologie politique et anthropocène. »
Photo de têtière : François Mauger
Pour aller plus loin... Lire l'article d'Alexandre Monnin et Nathan Ben Kemoun
