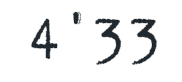Naïssam Jalal est l’une des figures les plus brillantes de la nouvelle génération du jazz à la française, celle qui revivifie l’héritage de John Coltrane et Miles Davis en le frottant aux musiques du reste du monde. La flûtiste ouvre son nouvel album, Un autre monde, avec un impeccable morceau dédié à la terre, Buleria Sarkhat Al Ard. Elle nous en parle, ainsi que de son rapport à l’environnement…
« Sarkhat Al Ard » signifie le « cri de la terre ». Comment fait-on pour prêter sa voix à la terre ?
Naïssam Jalal : En fait, la terre est trop vaste pour ma voix, c’est juste que je me sens concernée par l’urgence dans laquelle on vit, vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la situation écologique. Je me pose pas mal de questions sur le rapport de notre civilisation capitaliste au vivant : aux êtres vivants, aux êtres humains, à nos droits, à nos vies, à notre santé, autant qu’aux espèces qui ne sont pas humaines… Il y a un lien entre le mépris de nos dirigeants pour nos vies et leur mépris pour la vie tout court. Le lien est pour moi évident entre la façon dont on a sacrifié les hôpitaux et la façon dont on sacrifie les espèces. Ça m’angoisse. Je me dis qu’il va falloir qu’on se dépêche d’agir parce qu’on est au bord du gouffre. J’essaie de retranscrire toutes ces préoccupations, toutes ces émotions que je ressens, dans ma musique.
Tout au long des 7 minutes de cette Buleria Sarkhat Al Ard, l’auditeur a la sensation d’entendre une histoire, faite de chapitres qui se suivent. Le morceau s’ouvre sur une sorte d’aube, d’aurore. Le rythme est marqué mais lent. Votre flûte joue peu de notes. Puis une mélodie se dessine, sinueuse. Que raconte cette histoire ?
Naïssam Jalal : En fait, je n’avais pas d’histoire en tête, plutôt des émotions. La base de cette buleria est l’idée d’urgence, de cri. La narration n’est venue qu’après, quand j’ai travaillé avec la réalisatrice du clip, Béatrice Kordon. Il a fallu alors mettre des images sur la musique. Parfois, il y a des morceaux pour lesquels j’ai vraiment une histoire en tête dès l’origine, une histoire qui précède la musique. Parfois, c’est la musique qui précède l’histoire. Il y a alors une espèce d’aller-retour entre la musique et l’histoire qui se crée, puis un retour à la musique que je développe dans le sens de l’histoire… Tout dépend des morceaux.
Vos intentions de compositrice étaient de faire monter la pression ?
Naïssam Jalal : Complètement ! Pour retranscrire cette notion d’urgence… Il est question d’un cri, de la souffrance de la terre mais la terre est ici une métaphore. La terre sera encore là lorsqu’il n’y aura plus d’espèces pour l’habiter. Lorsque les dinosaures ont disparu, cela n’a rien changé pour la terre elle-même. La terre n’a pas besoin de nous. La terre, ici, c’est le vivant.
C’est un morceau sous tension. C’est même, vers la fin, un morceau en lutte. Mais ce n’est pas un blues. L’auditeur a l’impression que la lutte n’est pas perdue. Etait-ce votre objectif ?
Naïssam Jalal : C’est exactement ça. Il n’y a pas de tristesse. Il y a de la souffrance, il y a de la colère, il y a l’envie de lutter, d’agir… mais pas d’abandon.

De quand date votre inquiétude pour l’environnement ?
Naïssam Jalal : Une prise de conscience s’est faite petit à petit. Je ne pourrais pas dire exactement quand elle a commencé. Je crois que j’ai commencé par me poser des questions sur ma consommation de plastique. J’ai eu de longues discussions avec des amis proches. Ils me répondaient : « Naïssam, tu te sens coupable parce que tu utilises un sac plastique mais tu ne l’as pas fabriqué, tu n’as pas de prise là-dessus ». Quand j’avais 20 ans, je me posais plein de questions mais pas celles-là. Je m’interrogeais sur mon identité, sur ma place de fille d’immigrés en France. Ce sont des questions que je me pose toujours, mais moins fortement, parce que je suis allée en Syrie et en Egypte et que je me suis constitué une identité individuelle que j’ai choisie. Aujourd’hui, il me semble que, l’urgence climatique, on la perçoit de plus en plus au quotidien. C’est pire chaque été : les glaciers fondent, les icebergs se détachent… Je pense qu’on est de plus en plus nombreux à se poser des questions. Le fait que de plus en plus de gens fassent le choix de payer un peu plus cher mais d’acheter bio, le fait que des Amap se développent un peu partout pour acheter directement aux producteurs qui ont des modes de production alternatifs, le fait qu’on soit de plus en plus nombreux à discuter de ces questions-là, je pense que tout ça va dans le bon sens. Mais c’est encore trop lent…

Sur la pochette, vous posez sous un arbre, devant la raffinerie Total de Grandpuits, en Seine-et-Marne. Pourquoi ce choix ?
Naïssam Jalal : Je voulais créer un contraste, dire qu’on n’arrivera pas à « Un autre monde » sans en finir avec celui là. J’avais imaginé une photo dans un champ de fleur, avec l’usine derrière. On l’a prise, cette photo, elle est à l’intérieur de l’album. Mais quand j’ai vu ce pommier, avec ses pommes rouges, non loin de la raffinerie, j’ai trouvé le contraste bien plus fort. La photo évoque le jardin d’Eden : le paradis au premier plan, l’enfer au second. Le monde dans lequel on vit aujourd’hui n’est pas loin de l’enfer. La raffinerie symbolise à la fois l’industrialisation, le capitalisme, les intérêts qui justifient des guerres, toutes ces choses horribles qui sont arrivées depuis 100 ans… Cette photo, c’est aussi une façon de dire que les énergies fossiles vont finir par s’épuiser. Cette exploitation du vivant, des énergies fossiles, de la terre, de notre patrimoine à tous pour des profits à court terme arrive à son terme. Ce qui est fou, c’est que la photo a été prise en juillet 2020 et qu’en septembre, Total a annoncé qu’ils voulaient fermer la raffinerie. Ils se drapent derrière des considérations écologiques (alors qu’en fait, ils n’en ont rien à faire) mais la réalité est que le gros tuyau qui ramène le pétrole est endommagé. Ils préfèrent licencier plutôt que de le réparer et de travailler à une transition écologique, ou simplement de préparer le démantèlement du site. Les industriels n’ont aucune obligation de démantèlement des sites fermés. Je trouve ça aberrant. Dans le clip, on le voit bien : la cimenterie dans laquelle on a tourné est abandonnée depuis 20 ans.
La raffinerie de Grandpuits, elle, est au cœur de l’actualité. Les ouvriers du site ont fait la grève pour dénoncer l’hypocrisie d’une reconversion vers les biocarburants et les bioplastiques, des produits qui créeront tout autant de pollution, voire plus. Ils sont soutenus par Attac, Greenpeace, Les Amis de la Terre…
Naïssam Jalal : Je n’avais pas du tout anticipé ça. Mon idée n’était pas du tout de surfer sur leur grève. D’ailleurs, j’ai pris la photo avant. Ce jour-là, tandis qu’on se posait beaucoup de questions sur la meilleure façon de retranscrire nos préoccupations dans la photo, on était saisi par l’odeur : ça puait. Je ne comprenais pourquoi ça sentait si mauvais. On a fini par découvrir que, juste à côté de l’endroit où on prenait la photo, il y avait un tout petit cours d’eau. Quelqu’un avait tué 5 ou 6 renards et les avait jetés là. Les chairs étaient en décomposition. C’était affreux. Dans ce genre de cas, il est parfois dur de garder espoir, de dire que l’homme va être assez intelligent pour changer.
Aujourd’hui, votre vie de musicienne est malheureusement presque à l’arrêt. Dans quelles conditions va-t-elle reprendre ? Et quelle place y prendra votre inquiétude pour l’environnement ?
Naïssam Jalal : Moi, quand j’invite des artistes étrangers, je fais tout pour qu’ils aient plusieurs dates, qu’ils ne prennent pas l’avion que pour un seul concert. Mais il y a des organisateurs qui veulent te faire venir à l’autre bout du monde et qui veulent l’exclusivité ! Plutôt que de profiter d’être là pour donner 4 ou 5 concerts dans le pays et, au lieu d’y aller une fois tous les 3 mois, d’y aller une bonne fois et de n’y retourner que 3 ans plus tard, tu es confronté à des personnes qui sont dans des logiques d’exclusivité… Il faut qu’il y ait une prise de conscience globale ! Moi, chaque fois que je peux prendre le train plutôt que l’avion, je prends le train, c’est évident. Mais c’est la conscience de tous qui doit changer. C’est en discutant plus souvent de ces questions-là qu’on y parviendra.
Photo de têtière : Cénel et François Mauger Photos de Naïssam : Seka